
Le travail occupe une place importante dans la vie des Français. Ils estiment qu'ils s'accomplissent dans le travail pour 50 % d'entre eux alors que la moyenne européenne est de 30 %.
Et pourtant les Français aimeraient que le travail prennent moins de place dans leur vie. Tout un paradoxe à essayer de comprendre avec cette étude.
Le paradoxe tricolore
Alors que certains sociologues comme François Dupuy montrent bien que si les conditions de travail se sont améliorées avec le temps (grâce en particulier à la prévention de la pénibilité qui protège la santé physique des travailleurs) les conditions du travail (qui quant à elles s’adressent plus à la santé mentale des travailleurs) se sont détériorées, mettant en exergue la constance du caractère dual du travail, quand les travailleurs seraient en droit d’attendre du progrès qu’il transforme le travail en en gommant le caractère néfaste pour leur santé psychique et physique.
Paradoxalement, depuis qu’elles existent, les enquêtes européennes mettent en évidence que les Français accordent une très grande importance au travail.
Comment expliquer un tel plébiscite ? À quelle dimension du travail les français se réfèrent-ils ?
Dans l’article de Lucie Davoine et Dominique Méda publié en 2009 (« Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie des Français par rapport aux Européens ? »), les auteures mobilisent des enquêtes européennes et françaises pour cerner les spécificités de l’attachement des Français au travail mais aussi explorer ces différentes dimensions et cette singularité française.
- Elles démontrent un rapport spécifique des Français au travail : si le travail occupe une place centrale dans la vie des Européens, il occupe une place plus singulière encore pour les français dont près de 70 % jugent que le travail est « très important ».
- Elle montrent qu’à la fin des années 2000 il existe toujours un lien très fort entre l’importance accordée au travail et le taux de chômage - insécurité sur le marché du travail, comme Christian Baudelot et Michel Gollac (Askenazy et al., « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser »; Baudelot et Gollac, « Salaires et conditions de travail ».) l’avaient antérieurement mis en évidence par une enquête de 1997.
- Pour autant Lucie Davoine et Dominique Méda ont montré que le seul lien travail /chômage-insécurité sur le marché du travail ne suffisait pas à expliquer l’importance que revêt le travail pour les français.
Elles ont mis en évidence les racines de la vision spécifique des français, leur définition de l’intérêt intrinsèque du travail :
Si l’éthique du travail (au sens où le travail serait considéré comme un « devoir à l’égard de la société ») ne semble pas à l’œuvre, l’éthique du devoir semble être à privilégier : plus de 60 % de nos concitoyens continueraient à travailler même s’ils n’avaient pas besoin d’argent.
Mais puisque le salaire ne semble pas être le seul moteur, qu’est-ce qui peut donc motiver à ce point les français et les différencier des autres travailleurs interrogés ?
Les Français se distinguent en fait par l’importance qu’ils accordent à l’intérêt intrinsèque de l’emploi :
d’après l’ISSP (International Social Survey Programme qui regroupe plus de 42 pays), près de 65 % de la population déclare cet aspect « très important » en 1997 et de nouveau en 2005 alors que cette proportion est moins élevée dans la plupart des autres pays européens.
Les Français sont les interrogés les plus nombreux à estimer que le développement de leurs capacités passe par un travail : plus de la moitié sont « tout à fait d’accord » avec l’idée que le travail est nécessaire pour développer pleinement ses capacités.
C’est le score le plus élevé d’Europe. Ils sont moins de 20 % à partager cette opinion en Grande-Bretagne, en Suède et en Finlande.
Le travail, un investissement affectif pour près de la moitié des Français
On l’aura compris, le travail occupe une place tout à fait singulière en France.
Les Français accordent une importance spécifique à l’intérêt du travail, qui ne peut s’expliquer ni par les caractéristiques de la population en emploi ni par les effets de contexte.
En France , le travail correspond plus fréquemment à un investissement affectif : près de la moitié des français jugent qu’ils « s’accomplissent souvent dans le travail » pour une moyenne européenne de 30 %. Ils plébiscitent les notions d’accomplissement et de fierté alors que les Britanniques, par exemple, évoquent plus spontanément l’idée de routine, marquant un rapport plus distancié au travail.
Philippe d’Iribarne a mis en évidence dans « la logique de l’honneur » publié en 1989 ( d’Iribarne, « Les entreprises françaises et la logique de l’honneur ». ), la fierté et le devoir inhérents au rang qui poussent les ouvriers français à se dévouer à leurs tâches, à bien faire au-delà des comptes à rendre (ce serait déchoir que de faire du travail de mauvaise qualité, du travail dont on ne pourrait être fier !).
En étendant cette observation à l’ensemble des travailleurs on comprend bien que la vision française du travail échappe à la logique du marché pour s’appuyer sur une logique propre, celle de l’honneur du métier, la fierté du rang.
Au Moyen-Age notre société était divisée en trois « ordres » :
- le clergé dédié au service de Dieu,
- la noblesse qui préserve l’Etat par les armes et …
- le peuple qui produit les moyens de subsistance.
Cette structure implique de fait une stratification basée sur l’opposition entre pur et impur.
- Le clergé revendique sa pureté au travers de la chasteté et du service de Dieu qu’il se réserve tandis que le peuple, caractérisé par sa condition servile, est impur.
- La noblesse est en position intermédiaire quelque peu souillée par sa pratique des armes et du sexe mais étrangère à l’impureté de la condition servile du peuple.
La quête de pureté crée des sous-groupes au sein des ordres :
le compagnonnage du XIXème siècle qui permet aux ouvriers de se hisser au-dessus des ouvriers à la chaîne en reste trace vivante. A travers l’initiation, les épreuves, l’intronisation dans un Devoir, ces ouvriers très qualifiés ennoblissent leur travail même s’il reste manuel.
Je ne suis pas certaine que cette structuration sociétale autour d’une hiérarchie liée au travail ne soit plus d’actualité. Le travail au-delà de l’emploi revêt alors les caractéristiques d’un véritable statut social nécessitant alors des investissements aussi importants que les espoirs qu’il porte.
Travail je t’aime mais…
Lucie Davoine et Dominique Méda ont mis en évidence un paradoxe aussi spécifique aux français que leur vision du travail !
Si les Français sont les plus nombreux à déclarer que le travail est important ou très important, ils sont également les plus nombreux à souhaiter le voir occuper moins de place.
L’étude de l’ISSP de 2005 ( ISSP- Résultats pour la France – 2015 - Le sens du travail ), précisément consacrée au travail, montre pourtant qu’une part importante des Français continue, malgré un changement d’époque et de réglementation du temps de travail, à désirer réduire le temps consacré au travail. Comment expliquer un tel paradoxe ?
L’économiste et la philosophe proposent deux explications :
- Les dysfonctionnements propres au travail : les travailleurs dotent leur travail d’espoirs et attentes très fortes… mais verraient leurs attentes déçues en raison d’une part de l’incapacité du travail à les combler mais aussi des mauvaises conditions d’exercice du travail,
- Les autres sphères de réalisation ou d’expression de soi, les autres sources d’identité,
Le paradoxe du travail que les français élèvent au rang de valeur et qu’ils surinvestissent tout en souhaitant travailler moins s’expliquerait
- par l’insatisfaction issue de la sphère du travail et
- par la trop grande emprise de celui-ci,
- par son empiètement sur d’autres sphères jugées importantes,
- par le trop faible espace-temps qu’il laisse à ces autres activités
- et par les modalités défectueuses d’articulation entre les différentes sphères.
Dans la même veine, Thomas Philippon ("Le Capitalisme d’héritiers. La crise française du travail ") allègue qu’il n’y aurait pas de crise de la valeur travail en France mais l’expression d’un fort malaise au travail.
Les relations sociales en France seraient tellement exécrables que les salariés désespéreraient du travail et se mettraient en quelque sorte dans une position de retrait : la volonté de réduire la place occupée par le travail serait la conséquence de l’impossibilité de changer ce dernier et l’expression des difficultés ressenties dans la vie de travail.
C’est en effet en France que les relations avec la direction sont les plus mauvaises et que les salariés ont la plus mauvaise perception de leurs conditions de travail, de la sécurité de l’emploi et des aspects matériels de leur travail.
Ces éléments concourent à une forte déception vis-à-vis du travail (Garner, Méda, et Senik, « La place du travail dans l’identité » et Amossé et Chardon, « Les travailleurs non qualifiés ») alors même que le travail conserve un fort intérêt.
Les résultats de l’ISSP montrent que c’est en France que la proportion de travailleurs qui se déclarent stressés ou épuisés par leur travail est la plus importante.
- Les travailleurs français se plaignent aussi de la mauvaise qualité des relations sociales mais aussi de leur salaire. Ce bilan est d’autant plus désespérant que la France est en effet le pays où les chances subjectives de promotion seraient les plus faibles.
- Les conditions de travail, son organisation et les rétributions qui en découlent (salaire, sécurité, perspective de promotion) s’y révèlent, selon l’opinion des travailleurs, plus médiocres que dans d’autres pays européens.
Si dans l’inconscient collectif le travail reste un marqueur social, les conditions qui l’entourent ont pu susciter de telles déceptions parmi les Français qu’ils souhaiteraient réduire l’importance que celui-ci occupe dans leur vie.
Pour autant Lucie Davoine et Dominique Méda montraient bien que cette aspiration des français à voir s’amoindrir la place prise par le travail dans leur vie en 2009 n’était en aucune manière, comme cela a été prétendu de façon mensongère au moment de l’adoption des 35 heures, le signe d’une aspiration aux loisirs, d’un retour en force du « droit à la paresse » si cher à Paul Lafargue ou d’un désintéressement pour le travail. Il traduit plutôt l’expression d’un dysfonctionnement de la sphère du travail assez spécifique à la France ainsi qu’une intention positive de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Travail et santé, un mariage de raison
Au départ il y avait le travail, et ses conditions pesaient tellement sur la santé de l’outil (le travailleur !) qu’il a bien fallu en prendre un peu plus soin, sous la pression de la société quand elle fut éclairée par le progrès scientifique.
Pour parler de la santé au travail, je vous propose de vous parler de la fatigue, premier signe d’altération de la santé en lien avec le travail que l’on peut retrouver dans la littérature, comme un fil malheureusement suffisamment long pour nous conduire jusqu’à nos jours. Parlons donc des fatigues professionnelles pour parler du travail…

La fatigue professionnelle abordée dans les écrits dès le IV eme siècle
La fatigue professionnelle n’est pas née avec l’industrialisation ni nouvellement décrite.
A travers l’histoire, des symptômes d’épuisement professionnel ont été décrits, on peut citer la fatigue des moines anachorètes entre les IIIème et Vème siècle.
Dès le IVe siècle, les écrits théologiques sur l'acédie des moines distinguent la " bonne " de la " mauvaise " fatigue et évoquent les difficultés du travail intellectuel ou spirituel et associent le contrôle moral et social au discours sur la santé.
Ces dimensions ont traversé les siècles et sont toujours présentes dans les entités contemporaines de fatigue : Syndrome de Fatigue Chronique (SFC), burn-out, etc ( « marc Loriol le temps de la fatigue: La gestion sociale du mal-être au travail 2000 ») . Il n’y a pas toujours pas d’unanimité scientifique sur la définition de la fatigue.
Le seul point d’accord existant réside dans la distinction entre une fatigue provoquée par un effort et récupérée grâce au repos, et une fatigue « autre », non réparée par le sommeil et non expliquée par une pathologie organique. Cette distinction est supportée par un jugement de valeur qui distingue la « mauvaise fatigue » due à mode de vie malsain de la « bonne fatigue » résultant d’une activité socialement admise. Contre-intuitivement, seule la " mauvaise fatigue " longtemps considérée comme la marque exclusive des couches supérieures et des élites intellectuelles, a été décrite et socialement admise.
En 1700 la fatigue professionnelle est abordée dans le "Traité des maladies des artisans"
Il faudra attendre 1700 et le précurseur Bernardino Ramazzini, médecin italien qui dans son « Traité des maladies des artisans » pose les bases de la notion de maladie professionnelle en se préoccupant de l’usure au travail des classes laborieuses constituées essentiellement par les artisans et les ouvriers agricoles.
Il en recense dans son ouvrage les caractéristiques les plus usantes pour la santé et de façon encore plus innovante en relevant les formes de « sagesse et prudence » mobilisées pour éviter l’usure prématurée des travailleurs.
La fatigue du peuple, ignorée par mépris jusqu’alors, ne deviendra un sujet de préoccupation que lorsque l'industrie réclamera une main d'œuvre aussi importante en nombre que productive et précise dans l’accomplissement de sa tâche. La fatigue physique de l’ouvrier jusqu’alors négligée deviendra un réel sujet d’intérêt, la rapidité d’usure des ouvriers et le manque de fiabilité de la machine humaine devenant une réalité fondatrice des premières notions de l’hygiène industrielle !
Cette prise en considération aurait pu être porteuse de progrès mais avec la révolution industrielle, la notion d’insalubrité des professions change de contenu : la nature de l’activité passe au second plan au profit d’un examen global des conditions générales de la fatigue et de l’intensité des tâches…
En 1840 mise en cause des conditions de vie qui se rajoute aux conditions de travail
En 1840 Villermé présente une enquête qui constituera un tournant en contestant les travaux de Ramazzini et en mettant en cause les conditions de vie des familles ouvrières dans leur ensemble, et non pas seulement les conditions de travail.
Son analyse repose sur le principe que la santé de l’ouvrier n’est pas dissociable de ses conditions générales d’existence : elle s’oppose à toute analyse causale directe entre profession et santé. « L’insalubrité » est explorée à travers des conditions de fatigue, d’asservissement, d’excès de rythmes, de sous-alimentation, de « découragement » moral : « Seules certaines conditions générales contingentes, liées à l’exploitation industrielle, pouvaient rendre nocives la nature environnante, la nature des matières travaillées, la nature des exercices corporels » (Cottereau, « Usure au travail, destins masculins et destins féminins dans les cultures ouvrières, en France, au XIXe siècle »).
Villermé en mettant en avant des considérations morales dans le traitement de la problématique santé-travail va faire délégitimer toute velléité de prévention, en traitant l’usure et la fatigue dans un modèle de la santé englobant l’ensemble des conditions de vie et surtout les « mauvaises habitudes de vie » (« débauche », « intempérance », « imprévoyance »), il propose implicitement le partage dans la recherche des causes de toute maladie professionnelle, de ce qui relève de l’exercice professionnel et de ce qui est produit par les facteurs liés à l’individu et à son mode de vie.
Le vers est dans le fruit ! Seuls les enfants ne peuvent pas être reconnus comme totalement responsables de leur sort : « Trop souvent victimes des débauches et de l’imprévoyance de leurs parents, ils ne méritent jamais leurs malheurs » (Vernois, État hygiénique des lycées de l’empire en 1867; extrait du rapport présenté à S. Exc. le Ministre de l’instruction publique par le Dr Maxime Vernois. [Ausz.]).
Des éléments sociaux, scientifiques, politiques convergents, révélateurs d’un changement d’époque permettront les conditions nécessaires à l’émergence de nouveaux courants de pensée et de nouvelles études. Le renouveau viendra de la publication par Maxime Vernois, alors membre du Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, du premier traité explicitement consacré à l’hygiène industrielle, ouvrant la voie à de nombreuses et innovantes études consacrées aux maladies liées au travail comme la publication par Charles de Freycinet en 1866 de son rapport sur l’assainissement industriel (Freycinet, Rapport supplémentaire sur l’assainissement industriel et municipal en France et à l’étranger).
C’est dans ce courant que seront créés des distinctions particulières,
- pour l’exposition universelle de 1867 un nouvel ordre de récompenses « en faveur des personnes, établissements ou localités qui, par une organisation ou des institutions spéciales, ont développé la bonne harmonie entre tous ceux qui coopèrent aux mêmes travaux et ont assuré aux ouvriers le bien-être matériel, moral et intellectuel »;
- ou encore la création la même année à Mulhouse de l’Association des industriels de Mulhouse pour prévenir les accidents de machines.
- et la même année à Mulhouse par l’Association des industriels de Mulhouse pour prévenir les accidents de machines.
A partir de 1880, les travaux sur la fatigue se multiplient
Les discours hygiénistes relativisant fortement l’influence du travail industriel sur la santé au profit « des écarts de toutes sortes que les ouvriers commettent », sont rattrapés au tournant du XXème siècle
- par une dénonciation violente, dans la presse et de nombreux ouvrages qui ont traversés le temps (« Poème Melancholia - Victor Hugo ») , des conditions sanitaires de travail des ouvriers,
- puis par l’émergence d’un discours ouvrier sur l’hygiène au travail. La prise de conscience d’un droit nouveau – le droit à la santé au travail – s’accompagne de celle de nécessaires devoirs individuels et collectifs à l’égard de l’hygiène (REBERIOUX, « Mouvement syndical et santé-France 1880-1914 ») .
A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, le travail se retrouve non plus uniquement au centre de l’activité humaine, mais aussi de l’organisation sociale et politique et on assiste alors progressivement à une augmentation des cas d’épuisement professionnels.
Le demi-siècle qui suivra permettra de rattraper le retard pris dans l’observation, la démonstration et la reconnaissance des risques professionnels et en particuliers industriels.
1893 première loi sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs

Le législateur mettra près de 10 ans à prendre en considération ces risques nouvellement mis en évidence ou à nouveau démontrés pour les traduire en textes législatifs et réglementaires, et faire voter les propositions de projets de loi d’hygiénistes comme Henri Napias ou Jules Roche concernant enfin l’ensemble des établissements industriels:
la première du genre fut la loi du 12 juin 1893 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et son décret d’application du 10 mars 1894, imposent enfin les règles d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre dans les « manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances ».
La multiplication des porteurs de regard sur les conditions de travail de l’ouvrier modifiera progressivement la perception et la connaissance des risques du métier par l’ensemble de la communauté et l’ouvrier lui-même, lui permettant comme pour les ouvriers verriers, d’oublier l’orgueil lié à la difficulté physique du métier pour faire de la dénonciation des risques et de la préservation de leur santé le thème majeur et fédérateur de leur combat syndical.
Les études de la santé au travail au XXeme siècle
- En 1911 une étude décrit une « neurasténie des instituteurs »,
- en 1920 apparait la notion de « fatigue industrielle » et
- en 1956 des chercheurs décrivent « la névrose des téléphonistes ».
Il faudra attendre les années 1930 et les études et prises de positions aussi novatrices que courageuses de médecins engagés parmi lesquels nous citerons Henri Wallon, pionnier de l’étude des aspects du travail ouvrier et en particulier de la fatigue et du collectif de travail qui lui sont associés, mais aussi Louis Le Guillant auquel Yves Clot (GUILLANT et CLOT, Le drame humain du travail) rend hommage , relayées par le mouvement syndical, pour que le droit de souffrir d'une "mauvaise fatigue" soit reconnu à l’ensemble des catégories populaires : la démocratisation de la fatigue est allée de pair avec celle de la société et du savoir médical.
L’attention portée par les pouvoirs publics, les employeurs et les philanthropes aux conditions de travail des ouvriers tient à la fois à des principes affichés comme « humanistes » mais aussi à d’autres préoccupations bien moins philanthropiques :
- des enjeux scientifiques contenus dans la nécessité de consolider et d’approfondir de nouvelles disciplines que sont la nosologie et l’étiologie des maladies,
- des enjeux politiques car les souffrances au travail favorisent les grèves et les élans révolutionnaires.
- des enjeux démographiques et économiques du fait du coût de la souffrance au travail.
L’hygiène des ouvriers peut permettre de réduire les dépenses liées à l’assistance. Cet argument de bon sens économique constituera pourtant un obstacle : «Encouragement à agir dans le sens d’une amélioration sanitaire des conditions de travail, au nom des deniers publics et par espoir de gain à terme pour l’industriel, les exigences de l’économie sont aussi une entrave quotidienne que doit subir, contourner ou affronter l’hygiène industrielle » ( Moriceau, « Les perceptions des risques au travail dans la seconde moitié du XIXe siècle »). Elle est condition de bonne gestion économique si elle n’entrave pas les allures de l’industrie : ce qui lui impose un « devoir de modération » dans ses recommandations, préconisations.
Dans ses conditions, la fin du XIXème siècle verra fleurir les projets d’identification des règles optimales d’utilisation de la machine humaine et de gestion scientifique de la main-d’œuvre : comment augmenter la productivité du travail tout en réduisant l’usure prématurée de la force de travail ?
Deux camps s’affrontent :
- celui des « gestes efficaces économes en effort » J.-M. Lahy (1916) (Lahy, Le système Taylor et la physiologie du travail professionnel) dénoncera avec force les dangers du taylorisme tant pour la santé des ouvriers que pour la productivité,
- et celui défendu entre autre par la Ligue de prophylaxie et d’hygiène mentale créée en 1921 par É. Toulouse (Toulouse, La question sociale) qui prône la sélection rationnelle des travailleurs pour chaque poste et que le progrès passe par l’utilisation rationnelle des dispositions de chacun, scientifiquement diagnostiquées : la fatigue ici est le signe des effets néfastes sur le plan physiologique et psychique des « mauvaises orientations professionnelles ».
Pour autant personne ne peux remettre en question l’unicité de la fatigue : il est impossible de dissocier, dans le travail humain, ce qui relève de la fatigue musculaire et de « l’épuisement nerveux ».
Le sentiment subjectif de fatigue doit être pris en compte, au même titre que les mécanismes physiologiques. Et Lahy insiste sur la composante mentale du travail manuel : les ouvriers travaillent aussi avec leur tête… et pourtant il sera rattrapé par une tendance apparue dès le milieu du XIXème siècle : la tentation de prédisposer l’ouvrier aux maladies professionnelles sous couvert de potentielle faiblesses pré-éxistantes, ce qui permet en toute bonne foi de minimiser voire de nier la question de « l’insalubrité du travail », en reportant le problème sur l’inadéquation de l’ouvrier au poste occupé. Il s’agit alors plus de trouver le bon ouvrier pour une tâche qui ne saurait être modifiée plutôt que d’adapter cette dernière aux exigences de l’organisme humain qui la réalisera.
Loin de toute vision humaniste ou plus prosaïquement pragmatique c’est l’homme que l’on adapte à sa tâche ! il est même scientifiquement recommandé de : «Rejeter vers des travaux plus salubres que ceux de l’usine, vers le travail de la terre s’il le faut, les sujets prédisposés aux affections professionnelles de l’industrie est une œuvre de haute portée sociale » (Lhuilier, « Les «risques psychosociaux») .
Et c’est ainsi que l’on glisse dangereusement de l’identification de situations de travail pathogène à celle des individus à risques…
H. Wallon apporte lui aussi une contribution majeure à ces investigations sur la fatigue à travers sa critique du taylorisme dès le début des années 1930. L’organisation taylorienne alimente une fatigue mentale qui supplante la fatigue physique, et ce par l’amputation de l’initiative : ce qui « aboutit à l’effort le plus dissociant, le plus fatiguant, le plus épuisant qui se puisse trouver ». Cette contention « l’ampute d’une grande partie de ses disponibilités, qui laisse dans le silence toute une série d’activités nécessaires, de mouvements qui sont nécessaires parce qu’ils forment un tout en quelque sorte organique avec les gestes exigés.
On condamne l’homme à une immobilité qui est une tension continue. Or, cette tension qui ne peut se dépenser en mouvements entraîne des “troubles”, des dissociations qui détraquent la machine humaine. L’activité refoulée, empêchée (Clot, « La compétence en cours d’activité » - GUILLANT et CLOT, Le drame humain du travail) est sans doute un des éclairages majeurs de la santé mentale au travail qui reste malheureusement d’actualité aujourd’hui encore, sans doute même renforcée en cette période de pandémie.
Jusqu’au début des années 1980, les recherches sur le stress multiplient les facteurs de stress en une liste qui s’allonge au fil des publications :
- surcharge/sous-charge du travail,
- pression temporelle, excès ou manque de responsabilités,
- promotion excessive ou insuffisante,
- ambiguïtés et conflits de rôles…
Un bon majeur dans l’éclairage « des dimensions psychosociales du travail » est rendu possible par la publication à la fin du XXème siècle des travaux de Karasek (Karasek, « Lower health risk with increased job control among white collar workers ») en 1990 et de Siegrist (Siegrist, « Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. ») en 1996. Le modèle « exigences-contrôle » de Karasek montre que la détérioration de la santé n’est pas directement fonction de l’accroissement des exigences liées au travail mais du degré d’autonomie dont le travailleur dispose.
Le soutien social ou soutien technique et émotionnel est une composante importante de l’équation. L’isolement est repéré comme un facteur de morbidité et de mortalité. Le modèle « efforts-récompenses » de Siegrist met en avant la réciprocité perçue entre les investissements de l’individu et la rétribution reçue en termes d’estime, de statut et de gratifications monétaires.
Parlerait-on enfin de reconnaissance ?
Si les pressions opérées par les progrès technique, social et scientifique ont permis d’améliorer les conditions de travail, on est en droit de s’attendre à ce qu’il en soit de même des conditions du travail et de la santé des travailleurs.
Travail et santé : ...des promesses, toujours des promesses !
Six ans plus tard, l’enquête sur le « sens du travail 2015 » menée par l’ISSP, confirme factuellement les données mais tristement les analyses de Lucie Davoine et Dominique Méda.
Le travail déçoit encore… pardon, en toute honnêteté ce n’est pas le travail qui déçoit ce sont ses conditions de réalisation et au-delà la mauvaise connaissance qu’ont les travailleurs et les prescripteurs du travail, de ce qu’il est vraiment, de ce qu’il implique.
Pour Yves Schwartz (Durrive et Schwartz, « Travail et Ergologie »), l’homme cherche toujours à dé-neutraliser son rapport au milieu par ce qu’il y a quelque chose qui n’est pas vivre si l’on est assujetti aux normes d’un milieu, si l’on est une espèce de pion dans un milieu dont on subit les conséquences. Pour lui « ce n’est pas vivre çà », c’est « être » pour un corps purement matériel, mais ce n’est pas vivre pour un être vivant. Il énonce que l’intention technique pour l’humanité ou pour les groupes humains est certainement une manière de dé-neutraliser son rapport au milieu, d’avoir une emprise positive et donc, au lieu de subir le milieu, d’essayer d’y porter trace de ses propres normes de vie. C’est aussi passer d’un registre pensé sans vous, un essai de le repenser en fonction de soi, comme en essayant d’établir un rapport de santé au sens large avec son milieu, en faisant prévaloir ses propres valeurs fondamentales de vie.
En clair le travail est l’un des moyens de l’Homme pour transformer son milieu d’où l’importance de trouver du sens au travail en dehors de l’impact financier.
Yves Schwartz propose que, « chacun cherche au travail un équilibre acceptable entre usage de soi requis et consenti ». L’échec est une souffrance, passer par l’analyse de l’activité peut aider à la dépasser. Il n’est pas démenti par Yves Clot pour qui « le travail réel a fait la démonstration de sa valeur économique pour la vie collective au-delà du seul marché. Il a aussi montré sa fonction psychique vitale pour chacun d’entre nous ».
Le « bien-être en France Rapport 2020 » de l’observatoire du CEPREMAP
Le « bien-être en France Rapport 2020 » de l’observatoire du CEPREMAP publié sous la direction de Mathieu Perona et Claudia Senik (Perona et al., Le Bien-être en France) nous permet d’avoir une vision plus fraîche encore du rapport des français au travail.
En comparant les français aux autres européens, les auteurs mettent quatre points noirs en évidence :
- l’impact du travail sur la santé,
- l’équilibre des temps de vie,
- les conditions de travail
- et le management.
L’enquête révèle que pour les français le travail n’est pas synonyme de santé loin de là puisque ils sont 35% à déclarer qu’il affecte négativement leur santé et au niveau européen ils sont les plus nombreux à déclarer que la fatigue professionnelle empiète sur leur capacité à tenir correctement leur ménage.
Curieusement les français sont les européens les moins absents pour raison de santé, et pour cause ils sont 62 % à déclarer venir au travail même en étant malades.
On ne peut que s’inquiéter de l’image que renvoie cette enquête, celle d’un monde du travail qui s’inquiète trop peu des conséquences des conditions d’exécution du travail sur la santé des travailleurs ! Plus que les autres européens, les français pensent au travail même quand ils n’y sont pas. En terme de répartition des temps les choses semblent polarisées.
- Ce sont les cadres qui souhaiteraient le plus travailler moins ou donner une place moins prépondérante au travail dans leur vie,
- tandis que les travailleurs manuels non qualifiés souhaiteraient travailler plus.
Cette dualité s’explique sans doute par un excès de temps partiels subis et de contrats précaires pour les moins qualifiés tandis que les cadres au forfait jour n’arrivent pas à l’équilibre des temps de vie malgré leurs JRS.
Les français sont classés dans la moyenne basse européenne des répondants quand on leur demande d’apprécier leurs conditions de travail, leur exposition aux discriminations et leur sentiment d’être traités équitablement, traçant à gros trait un environnement peu enviable. Ce qui est sans doute le plus inquiétant c’est que près d’un quart d’entre eux déclarent être exposés à une forme de violence au travail. Même si cette valeur est à pondérer de notre sensibilité aux comportements hostiles, elle témoigne d’une prévalence élevée.
L’enquête European Working Conditions Survey
Sur la base d’un ensemble de questions, l’enquête European Working Conditions Survey (SECO, « 6ème Enquête européenne sur les conditions de travail 2015 ») construit un indice d’équité, de coopération et de confiance reflétant la qualité des relations de travail et la France se place à la quatrième plus mauvaise place, juste derrière l’Albani ! Ceci explique sans doute pourquoi les français sont en queue des pays européens dans leur réponse à la question « je suis prêt.e à travailler plus dur que je ne l’ai fait jusqu’à présent pour aider l’entreprise ou je travaille à réussir ».
Comment en est-on arrivé à un tel paradoxe, une telle défiance vis-à-vis de leur institution ou entreprise de la part de travailleurs qui se définissent comme construits au travers de leur travail ?
- Ils y voient toujours une source importante d’épanouissement,
- ont le sentiment d’y consacrer des efforts importants au point d’y perdre leur santé,
- sont très insatisfaits de la reconnaissance matérielle par le salaire et
- ont en plus le sentiment de ne pas être traités de manière équitable
- et de faire face à un management de mauvaise qualité.
La France fait partie des plus faibles scores sur l’indice de qualité du management, de même que le sentiment positif d’autonomie et de capacité à l’organisation tranche avec une opinion négative quant à leur capacité d’influencer les décisions importantes.
- On peut estimer par projection à 4 millions le nombre de travailleurs français en emploi peu ou pas heureux dans leur travail.
- LA DARES estime quant à elle cette proportion à près d’un actif occupé sur 5 !
Les résultats de l’étude montrent que la probabilité d’être insatisfait de son travail est aussi influencé par des éléments difficilement mesurables comme le manque de reconnaissance bien décrit par Siegrist et Wahrendorf (Siegrist et Wahrendorf, « Failed Social Reciprocity Beyond the Work Role ») en 2016.
Il faut bien réaliser qu’en terme d’ampleur, l’insatisfaction au travail façonnée par un travail sous pression est aussi importante que celle liée à une activité professionnelle physiquement exigeante, mettant en lumière que cette forme de pénibilité psychologique touche plus de travailleurs que la pénibilité physique.
Dans un autre registre, l’insécurité de l’emploi apparait systématiquement comme un facteur de mal-être au travail et le facteur d’insatisfaction le plus puissant au niveau européen.
Il est suivi de près chez les français par la sensation
- de ne pas pouvoir employer pleinement ses capacités (44% des actifs enquêtés),
- de ne pas être reconnu dans son travail à sa juste valeur,
- estimer ne pas avoir de possibilité de promotion.
Dans la décomposition de la satisfaction au travail le climat social est le plus fort contributeur : les mauvaises relations avec les collègues et les tensions avec le public sont fortement incriminées.
- La part d’insatisfaits est trois plus élevée chez les actifs occupés ayant des mauvaises relations de travail avec leurs collègues que chez ceux entretenant de bonnes relations.
- La pénibilité psychologique est plus répandue chez les cadres et professions intellectuelles supérieures qui à près de 43 % déclarent travailler toujours ou souvent sous pression contre près de 36% de professions intermédiaires, 26 % des employés, et 22% des ouvriers.
Ces proportions s’inversent lorsque l’on considère la composante de la pénibilité physique.
La confiance résonne fortement dans cette étude, personne ne remettant en cause son aura : le besoin d’estime et de reconnaissance est à l’origine outre de la confiance, de la motivation et de la production des salariés.
Près d’un salarié sur 5 déclare ne faire que parfois voire jamais confiance à l’information provenant de ses supérieurs ou responsables. De là à incriminer la circulation de l’information et la qualité du management, pointés du doigts par les répondants français…
L’étude montre une relation forte entre les mesures de confiance et le niveau moyen de satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur vie professionnelle, et que la circulation de l’information et la participation des salariés aux décisions sur différents thèmes structurent fortement la satisfaction vis-à-vis du climat social.
Travail, Usure mentale ; souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale
Travail, Usure mentale ; souffrance en France : la banalisation de l’injustice sociale ; la valeur du travail ; violence au travail : la blessure des travailleurs ; l’entreprise barbare… Christophe Dejours, le père de la psychodynamique du travail ne nous laisse pas beaucoup d’espoir sur la destinée des travailleurs, plus assignés à être broyés par l’entreprise qu’émancipés par le travail !
Que dire des écrits d’Yves Clot initiateur des recherches en clinique de l’activité à qui l’on doit :
- éthique et travail collectif
- controverses, le travail peut-il devenir supportable, le travail à cœur
- pour en finir avec les RPS, travail santé mentale et conflit
- les servitudes du bien-être au travail…
Est-il utopique de vouloir en 2021 se réaliser dans son travail, un travail qui pour soi a du sens et permet de se dépasser, de progresser et pas uniquement de subvenir à ses besoins matériels ? J’ose croire que OUI ! Je peux vous aider à redonner ses lettres de noblesse au TRAVAIL dans votre entreprise, vous accompagner dans la réflexion et la mise en œuvre de votre politique de Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
Claudia Senik (Federspiel, « Claudia Senik, Bien-être au travail. Ce qui compte ») en 2020 a mis en lumière dans son ouvrage «bien-être au travail : ce qui compte », que les enjeux du bien-être au travail sont désormais reconnus comme un objectif légitime, le travail représentant près de la moitié du temps des actifs à savoir 2/3 des français de plus de 15 ans et la moitié de la population française.
Le bien-être au travail est un ingrédient essentiel à la satisfaction générale dans la vie. Elle revient sur les trois sources de bien-être au travail à savoir
- le capital social,
- la confiance et
- le climat social au sein de l’entreprise.
Le capital social peut être considéré comme la somme des interactions sociales par lesquelles les individus sont reliés les uns aux autres et qui jouent de fait un rôle primordial dans le bonheur des individus au sein de l’entreprise, des groupes et des sociétés. Sa qualité peut être évaluée au regard du soutien dont est capable le collectif de travail mais aussi par la qualité des échanges, du respect et de la qualité de la communication.
Le capital social représente « l’accumulation au cours du temps de relations de confiance au sein d’un groupe de personnes ».
Claudia Senik explicite bien la notion de « capital » social en démontrant que la confiance, qui n’est pas dans ce cas thésaurisée mais circule, peut ainsi engendrer des bénéfices ultérieurs : communication plus aisée, comportements plus coopératifs, plus haut degré de bien-être au travail. Cette confiance partagée serait à même de permettre et de mettre en mouvement la coopération.
Au niveau individuel on sait d’après les travaux de Mayer, Davis et Schoorman (Mayer, Davis, et Schoorman, « An integrative model of organizational trust ») publiés en 1995 que les trois principaux ingrédients de la confiance en une personne sont
- le degré de compétence,
- de bienveillance
- et d’intégrité
qui lui sont attribuées. Si l’on élargit cette vision au cercle des collègues ou à la hiérarchie on obtient une image très proche de ce que l’on peut nommer climat social. Elle met en avant l’importance de la taille, l’organisation et le sens de la hiérarchie, dans le bien-être au travail.
Le rapport d’Eurofound (Krieger, Graf, et Vanis, « Sixième Enquête européenne sur les conditions de travail en 2015 ») de 2017 suggère que le climat social est meilleur au sein des petites entreprises que dans les grandes car il semblerait que les relations entre collègues y sont plus denses et la chaîne hiérarchique moins longue. Cela permettrait entre autres d’instaurer de manière privilégiée la confiance entre les collaborateurs lors de coopérations plus horizontales.
La plupart des travaux consacrés à la hiérarchie montrent que la verticalité et la rigidité des règles, l’excès d’autorité nuiraient au capital social et sont néfastes au bien-être des salariés en restreignant l’autonomie, l’initiative et le champ d’expérience des salariés.
La pandémie de Covid-19 a secoué et fragilisé l'entreprise
On parle souvent de la reconnaissance comme condition du travail bien fait, mais dans cette crise sanitaire que nous traversons c’est le travail bien fait au bon moment et au bon endroit qui a forcé la reconnaissance.
On savait l’importance pour la santé de pouvoir faire quelque chose dans quoi on se reconnaît. Contre les habitudes une situation normale s’est trouvée très momentanément rétablie : être reconnu comme utile quand on l’est.
La force serait de pouvoir créer les conditions de la durabilité de cette reconnaissance. Pour cela est-ce qu’il ne serait pas utile d’ouvrir les lieux de décision aux professionnels venus du terrain, comme le propose Yves Clot dans son dernier ouvrage collectif le prix du travail bien fait (Clot et al., Le prix du travail bien fait), de revoir les frontières entre dirigeants et dirigés ? L’initiative doit être construite pas les intéressés sinon les conditions sociales et psychiques du travail ont peu de chance de se métamorphoser d’elles même, alors qu’elles sont le socle de la santé au travail.

La pandémie de COVID-19 que nous traversons a considérablement secoué et fragilisé l’entreprise et cela à différents niveaux, c’est incontestable. Elle a aussi contraint chacun à une introspection inédite par sa survenue et parfois son intensité. Le travail et ses différentes composantes ont été interrogés par chacun, quel que soit son poste et son rang dans l’entreprise.
Je crois qu’il y a urgence pour les dirigeants d’entreprises, les DRH, l’encadrement stratégique et opérationnel à se faire accompagner pour tirer les enseignements de cette période difficile absolument nécessaire à interroger-consolider voir revisiter le TRAVAIL dans l’entreprise afin de permettre à chacun de (re)trouver le sens du TRAVAIL et la CONFIANCE dans l’entreprise, qui sont absolument nécessaire à une reprise consolidé et durable de l’activité de votre entreprise quelle que soit sa taille.






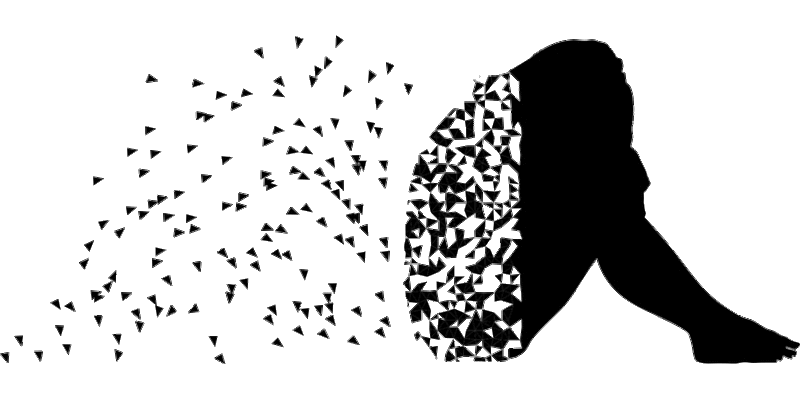

Écrire commentaire